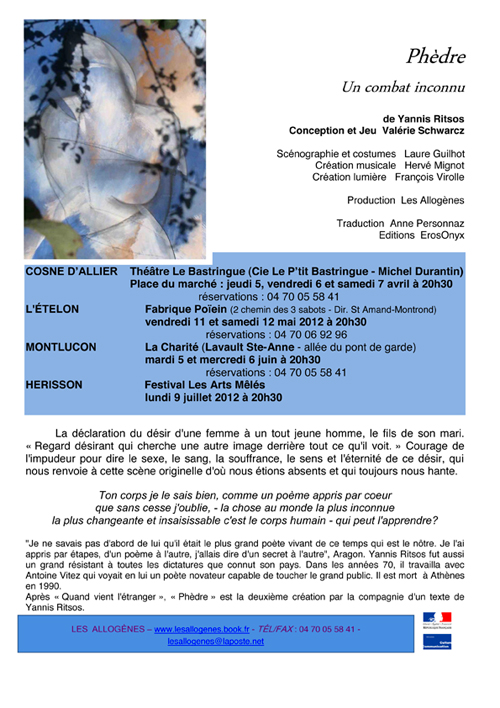L’âme de François Augiéras s’en est allée le 13 décembre 1971. D’un troisième infarctus – il avait quarante-sept ans – à l’hôpital de Périgueux où, de Montignac dont l’hospice l’hébergeait comme indigent, il avait été transporté d’urgence.
Et dans la solitude. Deux ans auparavant, le divorce avait été prononcé à ses torts exclusifs. Depuis 1968, il correspondait avec Jean Chalon qui ne l’a jamais rencontré. Paul Placet, son ami si proche n’était pas près de lui.
François Augiéras est inhumé à Domme, dans un coin du cimetière, sans pierre tombale, juste quelques pierres sur sa sépulture, des fleurs quelquefois, un galet en forme de cœur, et son nom écrit avec maladresse sur une plaque fichée dans la terre. Trois personnes étaient présentes à son enterrement. Enterré comme un chien ? Non, mais comme le dernier primitif , comme « un barbare en Occident » , comme un païen mais un païen qui croyait à la survie de l’âme.
Augiéras se voulait païen, contre le christianisme coupable à ses yeux d’avoir coupé l’amour charnel de tout dépassement spirituel, d’avoir défait les liens de l’humain avec le sacré véritable que sont les forces du monde. Pour lui, la religion authentique était celle qui unit tout le vivant et les astres dans « la sainte joie de vivre » . Affaibli, miséreux balloté d’un hospice à une maison de repos, n’ayant plus que quelques mois à vivre, Augiéras revendiquait encore cette union avec l’universel : « Dans le fond, écrivait-il à Jean Chalon, je n’aime que l’aventure, j’aime l’univers ; c’est mon seul amour véritable ! Je fais l’amour avec le monde… et j’en tire des livres ! » Vivre avec le monde, c’était, pour lui, laisser s’interpénétrer un corps et une âme en communication avec le grand Tout, à la fois se laisser habiter par Éros et Pan au plus près du monde, c’est-à-dire loin de la ville, loin de la civilisation, dans le désert d’Afrique comme du Périgord noir.
L’âme d’Augiéras, c’était son corps vibrant avec le monde, un monde brut, de forêts, de sable, de pierre, de sources, de ciel étoilé, jouissant de tous les parfums, celui du thym, de la résine des pins, des senteurs âcres, aussi bien et surtout de suint, d’urine et d’écurie, des odeurs de sueur et de crasse que pouvait exhaler la peau des bergers. Loin de la « civilisation », Augiéras communiquait avec les dieux, dans une union charnelle avec le monde, son âme et son corps ne faisant qu’un dans une volupté proprement magique. Seul auprès d’un jeune arbre, il l’aimait d’amour :
À genoux au pied de l’arbre, mes lèvres sur ses douces écorces, je lui parlai tendrement en une sorte de murmure à demi-chanté, tiré du plus profond de mon être et de ma vérité (…) Je défis la boucle de ma ceinture, j’enlaçai l’arbre et je fis la femme avec lui, torse nu, les flancs serrant le tronc entre mes cuisses.
Dans son âme ainsi incarnée, son âme charnelle, féminin et masculin s’entremêlent indistinctement pour retrouver l’union première (faut-il penser au mythe platonicien de l’androgyne ?).
Dans mes rapports avec l’arbre, ce qu’il y avait en moi de femme venait des premières nuits de la terre ; ces amour des feuilles datait des premiers soirs, des premiers Paradis, et me composait un curieux caractère de magicienne. Une profonde mémoire me revenait dans un flot de plaisir.
Cette âme a une matérialité, une essence physique, elle est bien plus qu’une simple humeur corporelle ; Augiéras, abondamment, en fait un usage religieux, cultuel même. Lui-même qui nous invite à cette identification de son sperme à son âme ou l’inverse. Lors de ses errances au Maroc, il a rencontré Alec qu’il « aima » soudain de toutes ses forces dès que leurs regards se furent croisés. Ils se retrouvent de temps en temps et, à la nuit tombante, à Agadir,
Sur une immense avancée de sable et de pierre gagnée sur l’obscurité de l’Océan, près des houles que soulève un vent chaud, je le rejoins (…) J’embrasse ses lèvres, une main sur son épaule. Après avoir essuyé sur nos vêtements nos doigts mouillés par notre âme, il reste à genoux sur le sable …
Son âme s’écoule en Afrique, en Périgord, comme en Grèce. À El Goléa, il a offert son âme, cette âme, sa liqueur profonde, essentielle de son être, comme une libation :
Les astres scintillaient (…) primaire, j’adorais l’univers, à genoux sur les pierres (…) joie très pure, je brûlais parfois ma semence…
Pascal, lors de la nuit du 23 novembre 1654, avait, lui, rejeté, repoussé son corps quand il se sépara du monde « : Joie, joie, pleurs de joie…» pour connaître Dieu, le Dieu de l’Évangile, d’Abraham et de Jacob. C’est ce Dieu-là qu’abhorre François Augiéras qui trouve son salut ailleurs :
Moi aussi, j’ai connu la souffrance ; je n’ai pas pour autant inventé un Christ pour me sauver…
À la joie de Pascal, Augiéras, lui, oppose sa « joie très pure » dans l’offrande de son sperme,
Joie de mêler ma jeune force à la force des astres et des plantes ; en moi la soudaine apparition de la joie (…) un nouvel accord de l’Homme avec le ciel.
Lors d’une rencontre précédente avec un jeune Arabe de dix-huit ans, à Ghardaïa, son désir amoureux est tel qu’il en oublie le danger de s’aventurer dans l’obscurité, pour le rejoindre, sur une crête, par une nuit chaude et belle :
La joie de serrer mon ami sur ma poitrine, d’embrasser son visage me fit oublier la peur. Il me rendit mes baisers avec tant d’amour que les larmes me vinrent aux yeux.
Si Dieu existe, je lui dirai : voilà ce qui a été pour moi le comble du bonheur. Je n’ai pas craint d’affronter la mort pour faire l’amour ainsi : la volupté que Tu avais mise dans nos corps, nous l’avons jetée sur Tes pierres près des astres.
Est-ce provocation lancée au Dieu de Pascal, au Dieu chrétien ? Il l’interpelle bien plutôt, moins pour contester son existence, que pour récuser son anathème impardonnable jeté sur le sexe dont Augiéras, lui, a fait le lien avec les forces du monde. Pour Augiéras aussi, l’amour est à réinventer !
Dans Un barbare en Occident, Paul Placet raconte leur séjour, dans les années 50, près des Eyzies où ils se sont trouvé un abri :
Pour qui se passionnait alors de forces occultes, de magie, de communication avec l’univers du ciel, notre site était privilégié (…) Tout ici parle de l’homme primitif, de ses préoccupations de chasse, de sécurité mais aussi du rêve religieux qui fut le sien.
Une nuit de novembre, Augiéras allume un bout de bougie, s’éloigne sans rien dire et, dit encore Paul Placet :
Un grand vide s’est creusé autour de moi. François restera absent un temps assez long. Il vient de retrouver les gestes du sacré, les noces de l’homme avec la terre. Il est invité par toutes les forces de la vie et va renouveler le pacte (…) Nuit de Novembre, l’unité de l’univers, celle des astres, de la terre, des hommes et des bêtes. Mon ami doit prier, étreindre la roche, dire à la nuit profonde la force de son amour, le désir qu’il a de recevoir son approbation et d’être protégé par elle. (…) mon ami, mon frère offre sa passion, celle d’un homme vivant, d’un corps chaud irrigué par le flux puissant de la vie. La chair de François gémit et palpite farouchement quand il la déchire et verse son offrande aux âmes de la nuit.
En Grèce aussi, Augiéras a ainsi offert son âme. Lors de son voyage au Mont Athos, une nuit, alors qu’il se trouve seul sur les pentes de la montagne sainte, au milieu des arbres, il se tient immobile devant le feu qu’il vient d’allumer :
Je me savais aimé, accepté par de craintives présences que mon campement sur les roches intriguait, que ces flammes attiraient. Rien en moi qui ne participât sans réserve à cette féerie nocturne : pas une lueur de christianisme ; j’étais une âme intacte depuis la Préhistoire.
Précédemment reçu dans l’ermitage d’un moine que servait un enfant qui « comme tous les enfants qui vivent seuls avec un vieillard, loin des autres hommes (…) paraissait un peu fou, heureux, très libre ! », sous son masque d’humilité servile, il avait de cet enfant deviné une « vraie nature, assoiffée de caresses, très libre, peu chrétienne ». Cette nuit-là, « fasciné par le feu, (il sentait) naître en (son cœur) un étrange pouvoir ».
Des charmes, d’une tendresse profonde, vieille comme le monde, vraie nourriture des esprits quand vient la nuit, émaner des rocs, des oiseaux et des arbres, se posaient sur mes lèvres et pénétraient en moi.
On marchait dans l’invisible torrent : d’autres nourritures m’arrivaient par les eaux ! L’enfant sortit de l’obscurité, parut devant mes flammes (…) Il semblait avoir, d’instinct, dès le premier regard échangé, deviné que j’étais un autre lui-même, capable de satisfaire sans plus attendre, tous ses secrets désirs, et d’abord l’insondable besoin de tendresse entre les bras d’un adulte, qui est le fait de tous les adolescents primitifs (…) Mes derniers tisons, presque éteints, piqués de taches rouges, n’éclairaient que sa main qui tremblait un peu, sa main charmante, que je pris soudain dans la mienne.
Il n’attendait que cela !je le sentis frémir ; un immense abandon s’empara de tout son être, une joie délicieuse.
Avec cet enfant auquel, cette nuit-là, il donne toute sa tendresse, Augiéras quitte le monde des hommes. Tous deux, cette nuit-là, ne forment plus qu’un seul être, « un brasier à force de joie (…) saoulés de bonheur (…) au cœur d’un tourbillon de lumière » :
…un accord, infiniment répété, divin, au-delà de toute musique audible, nous transportait d’allégresse, jetait notre amour vers les constellations, nous ramenait à nos cavernes (…) nous laissait entre voir plusieurs fragments de nos vies antérieures, de nos amours passées, et, plus souvent, ne se situait en aucun lieu, en aucun temps, se suffisant à soi-même au centre immobile d’un perpétuel jaillissement de flammes.
Expérience mystique, initiatique de l’amour, dans laquelle on fait don de soi, entièrement, corps et âme confondus. « Sensation de totale immobilité, d’ivresse heureuse, de légèreté… », l’extrême de la joie, tandis que les eaux du torrent filaient à vive allure le long de la roche où l’enfant et le nomade se sont étendus.
Quand je rouvris les yeux, elles emportaient vite, en aval, des brindilles, des feuilles sèches, et de longues traînées blanches, laiteuses, tirées des profondeurs de nos corps enlacés ; de longues traînées de sève humaine, qui flottaient, dansaient sur les vagues, et disparurent dans l’obscurité.
Il faut relire ces pages magnifiques de la nuit d’amour entre cet enfant emporté par « un élan de naïve sauvagerie » et Augiéras qui garde de sa présence, une fois l’enfant parti, des traces sur son visage, ses vêtements, ses mains. Échange de corps à corps, d’âme à âme, corps et âmes intimement mêlées. Depuis quarante ans bientôt, l’âme d’Augiéras ne se déverse plus de ses moelles profondes, dans les sables d’El Goléa, ni dans la Vézère, ni sur les roches du Périgord noir ni dans les eaux d’un torrent de la Montagne Sacrée. Son âme, son âme de primitif et de sauvage, un primaire si raffiné pourtant, où est-elle ? Depuis quarante ans et plus, la terre, l’eau, le sable l’ont faite sienne, absorbée, assimilée. Elle y survit et aussi dans les astres auxquels il l’a si souvent offerte. La si modeste tombe du cimetière de Domme ne saurait la contenir. Âme singulière qui vit encore dans les mots laissés derrière elle, qui chantent et nous enchantent ou peuvent en agacer d’autres (ce qui ne lui déplaisait guère, doit-on dire), âme échappée à ce monde dans la plus grande solitude et la plus triste misère.
Ma plus belle œuvre d’art, serait-ce ma vie ? Ce que j’ai vécu, voilà surtout ce qui m’importe. C’est aussi la meilleure manière de s’élever contre les hommes.
Yvan Quintin